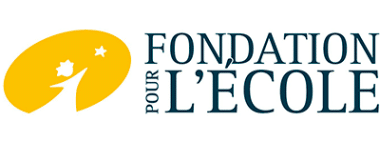Les écoles de production sont des écoles professionnelles sans contrat au fonctionnement original, entre scolarité menant vers CAP et Bac pro, et production réelle pour l’industrie. En forte croissance, ces écoles représentent une alternative indiscutable pour tous les jeunes pour qui l’école traditionnelle est inadaptée.
Un article très complet d’Elise Barthet du Monde du 24 avril 2018.
“Les écoles de production, rempart pour les décrocheurs”
Dans l’atelier d’apprentissage de Gorge de Loup, à Lyon, mardi 24 avril.
Élise Barthet
Les 25 établissements français accueillent un peu plus de 800 jeunes, sur les 100 000 qui sortent chaque année du système scolaire sans diplôme ni qualification. Cette forme particulière d’alternance suscite un regain d’intérêt chez les industriels qui peinent à recruter
Le bleu de travail a ce mérite : comme l’uniforme, il gomme tout. Dans l’atelier de l’école de production de Gorge de Loup, à Lyon, le fils de patron se confond avec le migrant, la fille avec le garçon. Chacun a les mains sales, les yeux rivés sur sa machine, des galoches de protection aux pieds. Et, pour puiser l’huile qui sert à graisser les rouages, tout le monde demande à Amandine Rousset.La jeune fille est penchée sur un grand cahier à spirales. Elle écrit des lignes de code : le programme qu’elle enregistrera avant de lancer l’usinage d’une pièce de métal. « Ça sort de ma tête comme si je parlais, dit-elle. J’ai toujours eu du mal à apprendre, sauf ici. On m’a mise derrière un établi et j’ai tout compris. La trigonométrie, le dessin industriel, la mécanique appliquée… Je ne vois pas le temps passer. Si on ne me le rappelait pas, j’oublierais de déjeuner. »
En classe de 4e, la moyenne générale de l’adolescente, fan de pop sud-coréenne, plafonnait à 7,6. Acceptée exceptionnellement à 14 ans à Gorge de Loup, parce qu’elle était « vraiment motivée », elle a bouclé, en 2017, un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) et compte bien, en 2019, décrocher son baccalauréat professionnel. Peu importent les minicoupures laissées sur ses mains par les tours et les longues heures de bus à s’agacer contre les pièces mal ajustées qui vibrent dans l’habitacle. Amandine, comme les 47 élèves de l’école de production, est assurée de trouver un emploi.
A mi-chemin entre le lycée professionnel et l’usine, l’établissement privé hors contrat qu’elle fréquente est d’un genre un peu particulier. Les élèves, à la peine dans le système scolaire classique, apprennent ici en mettant la main à la pâte. Ils produisent pour de vrais clients. Les deux tiers de l’enseignement se déroulent dans l’atelier, le reste en classe. Et, mis à part quelques établissements, la scolarité y est gratuite.
Un peu plus de 800 jeunes sont aujourd’hui inscrits. C’est peu, rapporté aux 100 000 adolescents qui sortent chaque année du système scolaire sans diplôme ni qualification. Mais la méthode a les faveurs de nombreux industriels qui luttent, depuis la reprise en 2016, pour trouver des candidats en phase avec leurs besoins. « Les résultats sont remarquables », notaient en février, dans une tribune publiée par Les Echos, une vingtaine de personnalités. Les écoles de production, ajoutaient-ils, sont« unesolution innovante qui a largement fait ses preuves en matière d’apprentissage ».
Innovante, peut-être, mais pas nouvelle. La première école, fondée par l’abbé Louis Boisard (1851-1938), a vu le jour à Lyon en 1882. Elle formait à l’époque des ébénistes et des cordonniers. Avec les années, le réseau s’est étoffé en Rhône-Alpes. Sur tout le territoire, on compte aujourd’hui 25 établissements. L’un des derniers-nés, l’EDEN School, à Villeurbanne forme, depuis septembre 2017, une quinzaine de jeunes aux métiers du numérique. Mais c’est dans l’industrie et le bâtiment que les écoles de production se distinguent.
« 100 écoles d’ici à 2028 »
« Si vous saviez le nombre d’offres d’emploi que je reçois… Rien qu’en ce moment, sur mon bureau, il y en a 84 », soupire Daniel Chambodut, le directeur de l’école de Gorge de Loup. Beaucoup d’anciens travaillent déjà dans les ateliers des fleurons locaux. Ils sont treize chez Velan, leadeur de la robinetterie industrielle. « Chez Montabert, où sont fabriquées des machines pour la construction et l’extraction, je ne peux pas les compter », égrène le chef d’établissement.
Depuis sa fondation en 1950 par le père Pierre André, prêtre-ouvrier dont la photo trône encore dans le bureau de l’administration, l’école a formé des milliers de jeunes inadaptés au parcours scolaire classique. Même le président de l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) Rhône-Alpes, Paul Rolland, fait partie des anciens. Sa société, Steec, spécialisée dans la micromécanique et l’usinage de précision, emploie au moins huit personnes qui ont appris, comme lui, sur l’établi.
Ce n’est pas un hasard si la plupart des maîtres professionnels qui enseignent en école de production y ont également fait leurs classes. Un esprit de corps règne dans les ateliers. Notamment à La Giraudière. L’établissement, sis à Brussieu (Rhône), a la particularité d’être installé en zone rurale. Parce qu’il dispose d’un internat, ses 128 élèves viennent de l’Ain, de l’Isère, de la Loire et du Rhône. Ou, comme Loïc Nesme, 19 ans, de la colline d’à côté.
Le jeune homme a choisi la métallerie après sa 2degénérale. Ici, « les profs sont carrément proches de nous », explique-t-il. Ce qui l’a le plus emballé jusqu’ici ? La réalisation d’un escalier quart tournant. « On apprend plein de choses dans le même ouvrage. Il faut être précis dans l’espace et travailler les finitions. »
Pièces en série, prototypes… Les jeunes touchent à tout pour coller au plus près à la réalité des entreprises. Mais, contrairement aux apprentis, ils ne sont pas rémunérés. Les gains tirés de la production comptent pour un tiers des recettes des établissements. S’y ajoutent les fonds de la taxe d’apprentissage et les subventions régionales et donations.
« C’est sûr que ne pas être payé à la fin du mois, ça fait bizarre au début, confie Loïc Nesme. Mais c’est motivant de savoir qu’on bosse pour de vraies gens. Ça nous permet de mieux apprendre, il faut l’accepter. » Le jeune homme compense en faisant des petits boulots pendant le week-end ou en réalisant de menus ouvrages pour ses proches.
Fin mars, le groupe Total a annoncé qu’il s’engageait à verser 60 millions d’euros sur dix ans à la Fédération nationale des écoles de production. Dominique Hiesse, qui préside en bénévole le réseau, espère, grâce à cette manne, quadrupler le nombre d’établissements, déjà multiplié par deux en sept ans. « On vise 100 écoles d’ici à 2028. Tout jeune doit pouvoir en trouver près de chez lui. »
Un soutien bienvenu, car les établissements risquent de pâtir de la réforme de l’apprentissage, dont une première mouture devait être présentée, vendredi 27 avril, en conseil des ministres. « Heureusement qu’on est bien avec les branches professionnelles, surtout celles qui sont sous tension », se rassure l’ancien patron.
« Auparavant, les parents ne voulaient surtout pas que leurs gamins aillent là-dedans. Beaucoup de métiers ont mauvaise réputation. Mais, depuis que le gouvernement s’est mis à plancher sur l’apprentissage, on sent un nouvel attrait. Des jeunes plus matures viennent nous voir », assure Jacques Marty, responsable des inscriptions à Boisard. L’école, qui porte encore le nom du fondateur, s’étend sur 3,5 hectares à Vaulx-en-Velin (Rhône) et accueille 120 élèves.
« De sacrés salaires »
Menuiserie-bois, aluminium, productique, métallerie, carrosserie, mécanique auto… Le terrain est une succession d’ateliers. A l’usinage, « m’sieur » Passalacqua règne sur une batterie de machines à commande numérique. La dernière arrivée a à peine 6 mois. Elle a coûté près de 300 000 euros. Un luxe que peuvent rarement s’offrir les centres de formation traditionnels.
A Boisard, où l’inscription est payante, le budget de fonctionnement avoisine 3 millions d’euros. Grâce aux subventions et donations issues de la région, des branches ou des fondations, les équipements sont régulièrement renouvelés.
« Nos élèves programment en NUM, en Fanuc et en Siemens, se félicite l’enseignant. A l’éducation nationale, ils ont surtout de vieilles machines ; c’est comme s’ils apprenaient aux jeunes le latin. Les nôtres, quand ils sortent d’ici, savent parler le langage de l’entreprise. Ils peuvent se faire de sacrés salaires. Au moins 2 000 euros net, c’est mieux qu’avec le bac. ;» C’est aussi ce qu’espère toucher après ses études Gauthier Dupont, flegmatique soudeur de 19 ans. Spécialisé dans la soudure Tungsten Inert Gas (procédé de soudage à l’arc avec une électrode non fusible), l’adolescent a un cousin passé par Boisard avec lequel il compte s’associer. Le travail en atelier le « détend », explique-t-il.
Mais l’apprentissage n’est pas aussi simple pour tout le monde. A la menuiserie, Clémence Carrio, 18 ans, confie avoir parfois du mal à suivre. Elle est, explique-t-elle, « multi “dys” » : dyslexique, dysorthographique, dyspraxique… « En résumé, ça veut dire avoir plein de problèmes dans une seule et même personne. » En pratique, cela signifie aussi travailler plus que les autres pour rester au niveau. « On galère dans les cours, on galère dans l’apprentissage. Je suis stressée en permanence », déclare-t-elle.
Pour les équipes, la variété des profils d’élèves réclame souvent une implication qui va au-delà de l’enseignement. « Beaucoup d’élèves sont en foyer. Il y a aussi des primo-arrivants qu’on nourrit, qu’on habille, qu’on accompagne chez le juge parce qu’ils ont reçu des obligations de quitter la France, détaille Daniel Chambodut. Il faut s’en occuper tout le temps si on ne veut pas qu’ils sombrent. Quand ils arrivent, les élèves sont comme des huîtres. Puis, ils s’ouvrent. »
Partager sur :
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp