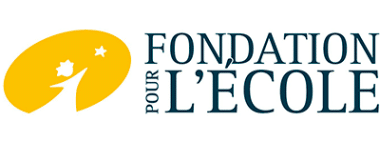Les écoles « différentes », c’est-à-dire celles dont le projet se situe dans la filiation des pionniers de l’éducation nouvelle (Freinet, Montessori, Steiner, Freire, Oury…), ont en commun la mise en œuvre de méthodes actives et une approche globale des savoirs ; il s’agit de partir des intérêts et des questionnements de l’élève, une approche globale des savoirs, le respect des rythmes de chacun, le développement de l’autonomie et la responsabilisation.
En France, ces pédagogies sont peu développées. Le contraste avec la situation d’autres pays est saisissant. On dénombre 22 000 écoles Montessori dans le monde, mais seules 296 écoles en France s’en réclament. Le mouvement Waldorf-Steiner compte plus de 3000 établissements sur les cinq continents, mais seulement 22 écoles françaises. La pédagogie Freinet serait pratiquée par 300 000 enseignants dans le monde, mais il n’existe que 21 écoles maternelles et primaires publiques « Freinet » en France.
Que ce soit dans le public ou dans le privé, en France, les écoles alternatives sont toujours restées minoritaires et à la marge des systèmes scolaires. Comment expliquer cette situation ?
Retour sur le contexte institutionnel
Tout d’abord, ces écoles et ces pédagogies ne bénéficient en France d’aucun soutien institutionnel. Dans le public, les écoles, collèges et lycées « différents », « expérimentaux », sont très peu nombreux. Comme nous l’avons montré dans une étude longitudinale, leur nombre est très stable sur la longue durée. Ainsi, les collèges et lycées « différents » de l’Éducation nationale étaient au nombre de 9 en 1983, et ils sont toujours 9 en 2021. Quant aux écoles primaires Freinet, il en existait 20 en 2001, 23 en 2013, et autant en 2021. Seules les structures alternatives pour les décrocheurs de plus de seize ans se sont multipliées depuis une décennie.
Certes, des établissements « différents » publics ont ouvert depuis quarante ans, mais dans le même temps, d’autres ont été fermés,
Quant aux écoles expérimentales publiques, elles sont pour la plupart d’entre elles fragilisées par des remises en cause et des tracasseries administratives. Ainsi, en juin 2019, la Fédération des établissements scolaires publics innovants avait alerté sur la situation subie par la majorité des structures expérimentales du second degré de l’enseignement public : non-renouvellement des postes ou non-nominations des enseignants formés à ces pédagogies, remise en cause des projets, fin des dispositifs spécifiques…
Dans le privé, les écoles hors contrat ne bénéficient d’aucune subvention, et la pression institutionnelle à leur égard s’est amplifiée. L’instauration de la loi Gatel en 2018 a rendu la création d’une école privée hors contrat plus longue et plus complexe en renforçant le contrôle du maire et des services de l’État au moment de l’ouverture et en élargissant la liste des motifs d’opposition. La loi « confortant le respect des principes de la République » adoptée en juillet 2021 a instauré la possibilité de fermer par simple décision administrative une école hors contrat.
Ainsi, dans le privé comme dans le public, les équipes porteuses de projets innovants se voient imposer des conditions de fonctionnement précaires et sont sans cesse aux prises à des demandes de « normalisation » qui épuisent et découragent les promoteurs de ces pédagogies.
Une conjonction de facteurs
Comment expliquer l’attitude des autorités publiques ? La réponse à cette question est complexe. Le blocage n’est pas dû, pour prendre une image, à un « gros caillou », mais à une multitude de « grains de sable ».
En premier lieu, la France est un pays de tradition centralisatrice et unitaire. En Belgique, en Flandre, chacun peut ouvrir une école à condition que le programme soit accepté par l’administration régionale et que les enseignants aient le diplôme requis ; l’école est alors subventionnée. Au Québec, un groupe de parents qui le souhaite a le droit – un droit établi dans la loi pour l’instruction – de demander la création locale d’une école alternative. Cela a permis l’ouverture de 7 écoles publiques différentes entre 2010 et 2016. En France, l’idée que les citoyens peuvent initier un projet d’école ne fait pas partie de nos habitudes culturelles.
Deuxièmement – mais ceci est lié à ce qui précède – l’attachement à l’idée d’égalité conduit souvent à penser que l’égalité des chances passe par un même enseignement dispensé à tous : tous les élèves français devraient suivre le même programme, avoir exactement le même nombre d’heures de mathématiques, entendre le même discours au même moment… Et ce, indépendamment de la variété des besoins, de la vitesse d’apprentissage, et des uns et des autres. L’idée que plusieurs chemins pourraient permettre de parvenir au même but n’est pas présente. Dans ce contexte, il n’y a pas de place pour la diversité éducative.
Troisièmement, la France est un pays où les exigences académiques sont fortes et où la priorité est donnée à la transmission du savoir. A l’opposé, dans les pays du Nord de l’Europe et les pays anglophones, le bien-être et l’épanouissement de la personnalité sont mis en avant en priorité. Ce constat est valable pour l’ensemble du système scolaire français, mais c’est pour la maternelle qu’il est le plus vif.
Depuis le milieu des années 1980, le jeu libre et la place des activités artistiques ne cessent de diminuer, les programmes sont toujours plus contraignants et plus axés sur les apprentissages fondamentaux, sur le modèle de l’élémentaire. Les textes officiels qui entrent en vigueur en septembre 2021 sont focalisés sur les disciplines (lire, écrire, compter…), avec des évaluations dès l’âge de 2-3 ans.
Un quatrième facteur explicatif est à chercher du côté de la formation des élites. Ces représentations sont particulièrement fortes chez les cadres de l’Éducation nationale, peu formés à accepter les « pas de côté ». Le mode de désignation de la hiérarchie joue dans ce sens. « Il y a bien vacances de postes, appel à candidatures, mais finalement les candidats les plus rénovateurs ne sont pas admis à concourir », affirmait Antoine Prost en 1998 à propos de l’inspection générale. Cela n’a pas changé depuis. Les membres de l’institution sont aussi d’anciens très bons élèves : ils leur est difficile de mettre en question un système qui leur a permis de réussir.
Des enjeux de représentation
Il y a une petite vingtaine d’années, nous avions écrit avec Marie-Anne Hugon un article analysant la faible diffusion des pédagogies différentes en France. Nous affirmions alors qu’elles étaient peu répandues parce qu’elles étaient très mal connues, notamment de la part des familles ; et que leur représentation dans l’opinion publique était souvent péjorative. Depuis, cette situation a nettement évolué.
L’essor des nouvelles technologies de l’information et de la communication leur a permis de se faire connaître très largement. La réalisation et la diffusion de vidéos, devenues plus faciles techniquement, ont permis de diffuser sous une forme plus accessible, à la fois un discours critique vis-à-vis du système scolaire (comme le montre par exemple le documentaire « Alphabet ») et une meilleure connaissance des alternatives – en témoigne, parmi d’autres, le succès du film « Être et devenir ».
Un mouvement en faveur d’une éducation plus respectueuse des enfants, dans un souci d’écoute et de respect de leurs besoins et de leurs émotions (« parentalité positive ») se développe, et favorise aussi la recherche d’une forme scolaire plus bienveillante. Dans un contexte d’accentuation du consumérisme scolaire et de défiance croissante à l’égard de l’École où rechercher le « meilleur » établissement pour son enfant est devenu la norme, un nombre croissant de familles souhaitent que leurs enfants puissent bénéficier des pédagogies nouvelles.
Du côté des enseignants, il est plus difficile de mesurer à quel point la connaissance et la représentation des pédagogies nouvelles a évolué. Leur formation ne fait quasiment aucune place à ces pratiques alors qu’on sait que c’est un des facteurs favorisant le développement de ces pratiques. On peut, à l’opposer, citer des exemples étrangers : ainsi, en République tchèque, des programmes américains sont proposés clés en main aux étudiants en formation qui peuvent par ailleurs choisir de se spécialiser dans les pédagogies alternatives. En Belgique, à Liège, depuis 2010, une formation continue est mise en place sur trois ans pour les enseignants des écoles Freinet, ce qui a largement contribué au développement des écoles Freinet dans cette ville.
Les enseignants français connaissent donc mal ces pédagogies. Une étude récente du ministère de l’Éducation nationale a montré récemment qu’au collège, la majorité d’entre eux « plébiscitent un mode d’enseignement caractérisé par une démarche directe, structurée et fortement guidée », autrement dit une pédagogie traditionnelle. Une des raisons à cette situation est qu’ils se sentent peu formés et peu compétents pour s’engager dans des pratiques autres : par exemple, moins de 25 % d’entre eux déclarent se sentir capables d’aider les élèves à développer leur esprit critique.
Certes, un nombre croissant d’enseignants découvrent les pédagogies différentes par d’autres moyens que celui de la formation institutionnelle et souhaitent s’en inspirer dans leurs classes, par exemple en favorisant le travail en autonomie, en développant le travail en classes « inversées » ou « flexibles » ou la pédagogie de la nature. Mais nombreux sont ceux qui doutent de leur efficacité et préfèrent le maintien de routines professionnelles qui présentent l’avantage d’être familières à tous, enseignants, parents, élèves. Au final, la question de la diffusion des pédagogies nouvelles touche aux représentations, c’est-à-dire à un domaine très éloigné du rationnel.![]()
Marie-Laure Viaud, Maîtresse de conférences en sciences de l’éducation, Université de Lille
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
Partager sur :
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp