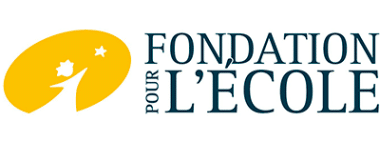Tribune. La crise sanitaire et le confinement n’ont fait qu’accélérer la voie que prend l’éducation nationale sur le chemin du numérique. Cours à distance, documents sur fichiers, corrections sur écran, autant de pratiques acceptées dans l’urgence mais que l’institution nous incite à adopter, par petites touches, depuis des années, dans une perspective affichée de modernisation.
Je n’ai rien contre cette évolution. Non seulement je comprends l’utilité des écrans tactiles et des applications pédagogiques, mais j’ai du goût pour ces progrès. Je ne vois pas trop, après tout, quel genre de fatalité les rendrait néfastes – la télévision n’avait-elle pas, en son temps, suscité des controverses ? Dans ma vie privée, je consomme de la musique numérisée, des films sur Netflix et des jeux vidéo ; en tant qu’enseignant, j’envoie des vidéos par mail, j’organise des ciné-clubs et j’emporte mon enceinte portative pour des extraits musicaux. En somme, je ne suis pas réfractaire à l’idée que la circulation accélérée des contenus permise par le numérique relance à une échelle inédite la révolution déjà opérée par Gutenberg.
Mes infinis découpages-collages
Malgré tout, je reste curieusement réfractaire à bien des usages. Je ne me résous pas à faire lire mes élèves sur tablette ni même à projeter des documents sur le tableau. Je ne me résous pas à truffer de documents l’espace numérique de travail. A la rigueur, créer ma page où les élèves se rendraient s’ils le souhaitent pour quelques lectures complémentaires. Mais j’ai déjà du mal à avoir recours à des manuels. Non seulement les textes proposés ne correspondent pas à ceux que j’ai lus, mais je me sentirais paresseux, et même corseté par une structure proposée par d’autres.
« On aurait pu croire qu’à l’heure des visioconférences et des fichiers joints la pratique du polycopié tomberait en désuétude… »
Pire, je n’ai jamais passé autant de temps à peaufiner mes documents photocopiés. Une part conséquente de mes préparations consiste à découper des extraits de livres que je possède – je ne veux pas me contenter d’extraits sélectionnés par d’autres – et à les organiser sur des pages A4. Pour la plupart des professeurs, le fantasme n’est-il pas toujours de tirer la substantifique moelle de livres qu’ils ont le plaisir de lire, de commenter, de tenir entre leurs mains, voire de griffonner, de surligner, d’agrémenter de commentaires ?
J’ai même continué mes infinis découpages-collages à l’occasion du confinement. On aurait pu croire qu’à l’heure des visioconférences et des fichiers joints la pratique du polycopié tomberait en désuétude… Mais, après quelques cours filmés, quelques enregistrements de mes cours, j’en suis revenu à mes découpages, que je prenais en photo pour les joindre à mes mails. L’idéal aurait été d’envoyer par courrier le résultat de mon travail… Et ce n’est pas d’un scanner ou d’une caméra que j’aurais dû encombrer mon bureau, mais d’une antique photocopieuse et de ramettes A4 !
Primauté de l’œuvre
Vous me direz que le numérique offre précisément l’occasion d’ajouter des hyperliens, des couleurs, de la musique à des textes qui de cette façon gagnent en présence, se connectant à une sorte de conscience universelle et palpitante. J’aurais cependant peur, cédant à la séduction des sens et des ramifications, de perdre de vue le cœur même du métier et de cette littérature qui m’a donné la vocation : les mots, les phrases, les livres…
Alors que, attaché à mes ciseaux, distribuant avec méthode mes séries de pages noircies, je garde l’illusion – mensongère ou pas – qu’il existe une primauté de l’œuvre et qu’il vaut la peine de se concentrer sur elle, quitte à oublier qu’il existe un contexte et même un monde autour d’elle.
Je reste donc l’un de ces enseignants-artisans cumulant les volumes dans sa bibliothèque et travaillant le papier. S’agit-il de paresse ? D’inertie face au changement ? De méfiance vis-à-vis de l’image ? De goût pour les matières – bruit des feuilles, poids des volumes, crissement des ciseaux – faisant pièce à l’univers trop cérébral de la littérature ? De superstition vis-à-vis des rituels entourant la littérature, et qui paraissent détenir en eux-mêmes une part de vérité ? Un peu de tout cela sans doute, et je suis partagé sur l’interprétation – positive ou négative – à donner à ce qu’il faut bien appeler une résistance au numérique, que je ne crois pas être le seul professeur à vivre.
Deux façons de résister
Pour essayer d’y voir plus clair, je distingue désormais deux façons de résister, deux façons dans lesquelles je me retrouve en dépit de leur apparente opposition : une conservatrice et une progressiste – à vrai dire, une antilibérale de gauche.
La première consiste à préférer la tradition des beaux livres à la nouveauté des claviers, à considérer que cet amour de la technique cache un intérêt pour des méthodes alternatives perçues comme démagogues. Dans cette perspective, la dispersion numérique est comprise comme un gadget, menaçant une culture sanctifiée par le passage des ans. Cette tentation conservatrice, Hannah Arendt la décrivait dans son article « La crise de l’éducation » [paru en 1961 aux Etats-Unis], et la plaçait même au cœur du métier dans le sens où le professeur se donne avant tout pour mission de présenter à l’élève le monde tel qu’il existe, tel qu’il doit même le protéger vis-à-vis de la puissance créatrice de l’élève.
La seconde relève d’une prévention plus générale contre un certain ordre néolibéral fondé sur la circulation, la fluidité, le repérage des compétences et l’insertion de l’individu dans un réseau toujours plus serré d’optimisation des ressources. Le numérique devient l’avant-poste du monde entrepreneurial, prompt à utiliser les citoyens et à les rendre utiles à leur tour. Dans ce monde-là, l’épanouissement des personnes sert l’épanouissement du système, dans ses composantes économiques comme dans ses injonctions morales. A cet égard, tablettes et cours à distance deviennent le cheval de Troie de l’entreprise dans la forteresse humaniste.
Quel point commun partagent ces deux formes de résistance ? Sans doute la conscience que le numérique reste un outil, dont l’éclat ne doit pas faire oublier la valeur de ce qu’il véhicule. Rappelons-nous l’expression d’« exception culturelle » : elle supposait déjà l’existence d’une sphère à préserver des jeux cruels de la pure économie. Le monde de l’éducation vit perpétuellement de cette tension. On attend de lui qu’il prépare l’élève au monde professionnel – et au monde moderne en général – tout en lui fournissant l’épaisseur d’une culture humaniste. Or, on oublie parfois que ces idéaux-là peuvent être amenés à se confronter, notamment par cette question de l’usage du numérique en classe.
Cette tribune paraît dans « Le Monde de l’éducation ».


 Le professeur de lettres et écrivain Aymeric Patricot explique, dans une tribune au « Monde », que « le numérique reste un outil, dont l’éclat ne doit pas faire oublier la valeur de ce qu’il véhicule ».
Le professeur de lettres et écrivain Aymeric Patricot explique, dans une tribune au « Monde », que « le numérique reste un outil, dont l’éclat ne doit pas faire oublier la valeur de ce qu’il véhicule ».