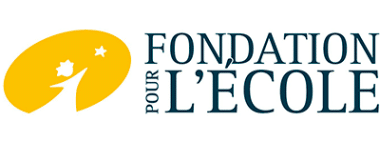En une dizaine d’années, les études de genre se sont installées dans l’université française sans qu’on mesure l’ampleur du phénomène. Aujourd’hui, elles représentent un discours présent dans toutes les disciplines des sciences humaines (lettres, langues, histoire, sociologie, anthropologie) qu’elles infléchissent ou tentent d’infléchir au niveau de l’enseignement comme de la recherche. L’université sert ainsi de vecteur à des idées qui, avec un soutien institutionnel massif, prétendent corriger une réalité mentale et sociale désignée sans débat possible comme nocive. Tribune libre d’un enseignant-chercheur.
En une dizaine d’années, les études de genre se sont installées dans l’université française sans qu’on mesure l’ampleur du phénomène. Aujourd’hui, elles représentent un discours présent dans toutes les disciplines des sciences humaines (lettres, langues, histoire, sociologie, anthropologie) qu’elles infléchissent ou tentent d’infléchir au niveau de l’enseignement comme de la recherche. L’université sert ainsi de vecteur à des idées qui, avec un soutien institutionnel massif, prétendent corriger une réalité mentale et sociale désignée sans débat possible comme nocive. Tribune libre d’un enseignant-chercheur.
Où trouve-t-on du genre à l’université ? Si l’on prend l’exemple des cursus de lettres dans une grande université de sciences humaines de la région Rhône-Alpes, il est présent dans les « séminaires de spécialité » que les étudiants choisissent chaque semestre en 3e année de licence (L3) et dans les deux années de master (M1 et M2) : parmi les 17 séminaires proposés en L3, trois se rapportent au genre ; en master, ils sont quatre sur 40 propositions. En outre, une séance sur douze est consacrée au genre dans les enseignements de tronc commun du M2 recherche que tous les étudiants de ce niveau suivent, qu’ils appartiennent ou non à la spécialité « études de genre », proposée à côté des quatre autres spécialités du master recherche en lettres modernes (« langue française », « littérature française », « littérature comparée », « littérature francophone »). Le séminaire de genre proposé au niveau M2 dans la spécialité « études de genre » (mais ouvert à tous) se propose significativement de concevoir « un ‘manuel idéal’ des études genre en littérature », celui « dont on aimerait disposer », dans le but de « s’interroger sur l’évolution et la reconfiguration des connaissances et des méthodes critiques, et sur la façon dont celles-ci passent de la recherche à l’enseignement et à de plus vastes publics » : l’intention militante est clairement affichée [1].
Les étudiants sont mis au contact du genre par un autre biais encore, celui des enseignements optionnels dits « d’ouverture » qu’ils doivent choisir en 2e et 3e années de licence, au rythme d’un par semestre. L’université leur fait 334 propositions, toutes disciplines confondues [2] : parmi ces propositions, 22 relèvent directement du genre et émanent presque toutes de la faculté d’histoire, par exemple « genre et famille », « genre et citoyenneté », « genre et politique », etc… La lecture des descriptifs correspondants permet de repérer des constantes : à partir des « recherches récentes », il s’agit de « mettre à jour » et donc de « déconstruire » des relations sexuées de « pouvoir » ou de « domination » dont les femmes surtout, mais aussi diverses minorités, seraient victimes, à cause des « normes » sociales auxquelles elles sont soumises de façon violente et qu’il faudrait « contester ». Nulle part, il n’est question de réfléchir au genre comme lieu de pouvoir : seules sont évoquées les « résistances » auxquelles il se heurte, destinées à être rapidement balayées.
La situation dans le domaine de la recherche profite encore davantage au genre, à cause de la manière dont est organisée et financée la recherche à l’université. Elle s’organise en effet en laboratoires, équipes et groupes qui sont appelés à définir des « axes » et à s’organiser en « réseaux » ; or le genre, qui se veut interdisciplinaire, s’offre tout « naturellement » à fédérer les intérêts dont il favorise ainsi le regroupement : quand on ne sait pas quoi faire pour trouver des thèmes fédérateurs, on fait du genre – d’autant que le genre rapporte beaucoup d’argent, et c’est là le nœud de l’affaire. Examinons comment est affecté l’argent de la recherche : les principales sources de financement en sciences humaines sont l’ANR (Agence Nationale de la Recherche), le CNRS (Centre national de la recherche scientifique), les régions et enfin l’Europe, instances qui, toutes, définissent des axes qu’elles dotent en priorité. Cette organisation est censée être plus efficace et donner plus de visibilité à la recherche ; en réalité, elle favorise son encadrement et l’« assèche » en l’uniformisant par le haut, au lieu que le financement récurrent (une dotation annuelle par exemple) laisse une plus grande autonomie scientifique dans le choix des thèmes de recherche. Or le genre fait systématiquement partie de ces quelques axes prioritaires et des « appels à projet » émanant des donneurs de fonds [3]. C’est la conversion de la volonté politique (un appui inconditionnel apporté aux études de genre) en moyens financiers.
Les études de genre occupent par conséquent, dans le monde de la recherche universitaire, une place symbolique et matérielle disproportionnée par rapport à leur importance intellectuelle réelle. On a ainsi vu se créer en 2012, grâce à cette manne publique, un « Institut du Genre » au sein même du CNRS. Localement, sont apparus un certain nombre de séminaires, ouverts aux chercheurs, doctorants et étudiants de master et animés par des équipes de recherche à cheval sur plusieurs établissements ou sur plusieurs disciplines, parfois avec le soutien d’associations de promotion du genre. On peut citer – toujours en Rhône-Alpes – le séminaire « Genre et société », créé par des historiens de l’ENS Lyon et de Lyon 2 qui travaillent « sur la dimension sexuée des phénomènes et processus historiques, partant du constat que toutes les sources que nous utilisons sont confrontées aux questions propres à l’identification du ‘masculin’ et du ‘féminin’ et aux rapports de pouvoir qui en découlent » et qui affichent un partenariat avec Mnémosyne, Association pour le Développement de l’histoire des femmes et du genre ; ou encore le « Séminaire interdisciplinaire sur le genre », hébergé par l’Institut des Sciences de l’Homme à Lyon, émanation d’un réseau de chercheurs rhône-alpins qui se réclament explicitement de « la reconnaissance institutionnelle tant par le CNRS […] que par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (qui en a fait un axe prioritaire dans le cadre de la Stratégie nationale pour la Recherche et l’Innovation). »
L’ensemble de ces manifestations ne représentent pas tant de personnes que cela : ce sont presque toujours les mêmes que l’on trouve occupées à animer les enseignements, à encadrer les mémoires et les thèses et à publier sur le genre. Il est vrai également que toute forme de pensée a sa place à l’université, avec ses hypothèses et ses constructions, fussent-elles contestables. Toutefois, deux phénomènes éveillent la méfiance à l’endroit des études de genre : c’est la volonté militante d’une part, et d’autre part le recours à l’intimidation, peu compatibles avec une démarche scientifique. Le militantisme d’abord : il installe les études de genre dans la posture de la minorité opprimée, alors qu’on vient de le voir, les études de genre bénéficient au contraire d’un soutien institutionnel et financier considérable – elles sont à proprement parler au pouvoir ; le militantisme a ensuite l’inconvénient de dispenser les études de genre d’avoir à se justifier : elles ont leur justification en elles-mêmes et ne tolèrent aucune forme de critique au nom de la lutte contre les inégalités et les stéréotypes – encore faudrait-il s’entendre sur ce que sont ces « inégalités » et ces « stéréotypes » auto-définis.
C’est ici qu’intervient l’intimidation : si au lieu de l’indifférence polie qui entoure la plupart du temps les études de genre, celles-ci se heurtent à des « résistances », le ton devient menaçant. On en veut pour exemple le texte de la pétition qui figure sur le site de l’Institut du Genre depuis les journées de retrait de l’école organisées par Farida Belghoul : on y lit que « les propos les plus extrémistes circulent, dans les rues ou sur les réseaux sociaux, réveillant les haines envers les homosexuels, les juifs, les féministes, les professeurs des écoles appliquant l’ABCD de l’égalité, les chercheurs en études sur le genre, tous présentés comme des ennemis de la société[4]. » La censure fonctionne parfaitement, car tout le monde tombera d’accord sur le fait qu’il est impossible de donner la parole à des homophobes antisémites, misogynes et obscurantistes ! Et de fait, nul n’ose s’opposer dans les universités à l’expansion des études de genre ni même à la pratique un peu ridicule des « cher.e.s collegu.e.s » et autres « enseignant/e/s » et « étudiantEs ».
Au bout du compte, sur le plan intellectuel, le refus de la critique et de la discussion condamne les études de genre. Car s’il est parfaitement légitime de s’interroger sur la part construite de toute identité sexuelle, il ne l’est pas de fournir les réponses en même temps que les questions et encore moins de vouloir imposer « l’intégration de la dimension du genre dans les projets de recherche », selon le programme de la journée d’information du 7 mars 2014 organisée sur ce thème au CNRS [5]. Le terme de « dimension » est révélateur : les études de genre ne se contentent pas d’occuper le terrain grâce à l’appui politique et aux moyens financiers dont elles disposent ; elles sont totalitaires au sens propre, dans la mesure où elles prétendent imprimer leur marque sur la totalité des recherches en sciences humaines, toutes appelées à avoir leur « dimension » genre. C’est de monopole qu’il s’agit.
Lazar Roche
[1] C’est aussi le cas du master et du Diplôme d’Université proposés par la faculté de sociologie de la même université sous le nom d’« E.G.A.L.I.T.E.S » (Études Genre Actions Lectures Interdisciplinaires pour tisser l’Égalité dans la Société), qui proposent « une formation innovante pour accompagner la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques d’égalité » puisque « les avancées en matière d’égalité des sexes, et plus généralement en matière de lutte contre les discriminations, demeurent insuffisantes à ce jour malgré les efforts de l’Union Européenne ».
[2] Toutes ne donneront pas lieu à des cours (il faut que les effectifs soient suffisants) et certaines se répètent d’un semestre à l’autre.
[5] http://www.mshparisnord.fr/gis-institut-genre/ Un grand congrès international sur les études de genre en France est annoncé sur le site pour septembre 2014, à l’ENS de Lyon.
Partager sur :
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp