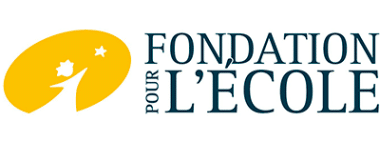Ce texte est paru dans « Le Monde de l’éducation ».
Bac de français : « Les nouveaux programmes ressemblent à une entreprise de formatage »
Tribune. Il est temps de déconstruire un préjugé tenace sur les enseignants : non, ils ne refusent pas toutes les réformes. A vrai dire, ils ne cessent de les absorber, d’essayer de s’en emparer, de leur donner du sens, y compris lorsqu’elles se contredisent d’une année sur l’autre. Mais aussi ils les questionnent, parfois les contestent parce qu’elles leur semblent aller contre le sens de leur mission, ou apporter une couche supplémentaire et inutile de difficulté.
La réforme du lycée, mise en place en septembre 2019 et qui bouleverse la structure et les contenus d’enseignement, a été fortement contestée sur ces deux aspects. La lettre envoyée par le ministre de l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, au comité de suivi le 6 janvier semble prendre acte, quatre mois après la rentrée, de critiques formulées par des enseignants, notamment en mathématiques, en anglais et en lettres, qui alertaient dès 2019 sur la difficulté des nouveaux programmes.
Il y aurait bien des choses à dire sur le bouleversement structurel du lycée, mais je m’intéresserai plutôt à la question particulière des programmes de lettres. Comme pour l’ensemble des disciplines, ils sont renouvelés en même temps pour les classes de seconde et de première. Les élèves de première aujourd’hui suivent donc un enseignement qui n’est pas dans la continuité de celui qu’ils ont suivi en seconde. Une situation particulièrement critique pour les lettres puisque l’épreuve finale du baccalauréat a lieu dès la fin de la classe de première.
« Logique de rendement »
Si l’examen en lettres semble rester formellement plus ou moins identique à ce qu’il était, son esprit change en réalité assez profondément. L’idée, louable, est d’encourager le candidat à être un lecteur actif, capable de proposer une réflexion personnelle sur les œuvres qu’il découvre. Mais ce que revendique là le programme est contredit par les conditions de sa mise en application dans les classes.
D’abord, l’horaire alloué, quatre heures par semaine, est insuffisant pour pallier les difficultés, aussi bien de lecture que d’écriture, d’un nombre toujours grandissant d’élèves. L’obstacle était une gageure, il devient insurmontable : le programme imposait jusqu’aux aménagements de début janvier d’étudier, au minimum, vingt-quatre textes à présenter pour l’oral, désormais entre vingt et vingt-quatre. On revient, un peu tard, à plus de mesure, mais on reste dans une logique de rendement qui transforme les enseignants en stakhanovistes de l’étude de texte, imposant malgré eux aux élèves une cadence absurde. Le plaisir de la littérature, déjà bien menacé, attendra des jours meilleurs.
Cette étude à marche forcée est peu compatible avec la construction de l’élève comme lecteur autonome et réfléchi, qui prend plaisir à découvrir pour lui-même la beauté d’un texte de littérature. Il faut encore, dans ce temps très limité, préparer les exercices de l’écrit, très exigeants dans leur forme académique et leur contenu, initier à l’histoire littéraire, et travailler la grammaire.
Le temps de la découverte et de l’errance intellectuelle
Au fond, cette contradiction des nouveaux programmes entre l’objectif affiché, les contenus imposés et les contraintes de temps laisse penser qu’ils sont conçus pour des élèves déjà formés et non des jeunes en formation, auxquels il faut laisser le temps de la découverte, de l’erreur, de l’errance intellectuelle avant l’illumination ô combien satisfaisante. Aucune place, ici, pour les chemins détournés où l’élève, au lieu de recevoir la parole d’en haut, fait vraiment sien le savoir qu’on lui transmet et se met à penser par lui-même, quand le maître reste une présence rassurante mais discrète.
La contrainte du baccalauréat, par nature, entrave la créativité pédagogique. Mais elle était encore possible dans l’ancienne version des programmes. L’enseignant pouvait, suivant la classe qu’il préparait, aménager le nombre de textes. Il avait, surtout, la liberté de construire entièrement sa séquence d’œuvres et de textes, autour de thèmes qui lui tenaient à cœur, à l’intérieur d’objets d’étude aux intitulés très ouverts.
Les descriptifs, ces documents qui rendent compte de l’ensemble des textes et des œuvres étudiés au cours de l’année et qui servent au jury d’interrogation pour l’épreuve orale, témoignaient de cette créativité. Ils étaient bien souvent source d’inspiration pour l’enseignant examinateur, qui y puisait l’année suivante des idées et des approches nouvelles pour enrichir ses propres cours.
Désormais, les œuvres et les parcours thématiques pour les étudier sont imposés. Nous avons certes le choix, pour chaque genre littéraire, entre trois œuvres. Mais entre l’ensemble de la littérature française d’un côté, et trois œuvres de l’autre, la marge laissée à l’initiative est singulièrement réduite. Il était prévu, dans un premier temps, que ces œuvres soient renouvelées par moitié chaque année. Est-ce à dire qu’il faut contraindre les enseignants de lettres au changement, sans quoi ils referaient éternellement le même cours, par paresse ? Un cours s’améliore avec le temps, l’enseignant apprend de ses erreurs et aussi de ses élèves, enrichit sa réflexion au fil de ses lectures, ses recherches.
Par ailleurs, l’immense majorité des enseignants renouvellent régulièrement, sans qu’on les y enjoigne, les œuvres qu’ils étudient parce que cela rend le métier bien plus intéressant. Là encore, on semble revenu à plus de raison : la lettre au comité de suivi propose un renouvellement d’un quart seulement. Néanmoins, l’injonction reste, et c’est elle qui pose problème.
Cette conception des nouveaux programmes de lettres oblige à se demander quels choix idéologiques réels les motivent. Des enseignants sont tentés d’y voir une volonté de mise au pas de leur discipline qu’ils vivent comme une agression, contre leur liberté pédagogique, contre leur expertise et contre l’idée même qu’ils se font de la littérature et de son rôle dans la formation des jeunes esprits. Les programmes ressemblent à une entreprise de formatage : ils imposent les œuvres, l’angle sous lequel les étudier, et jusqu’à la longueur des textes.
La créativité, qui est au cœur de l’activité littéraire, est ainsi réduite à la portion congrue. Aurait-on peur de la force subversive intrinsèque à la littérature qui, même aux époques les plus conservatrices, n’a cessé d’être un espace de liberté, de contestation, d’exploration des zones d’ombre de la société et de l’être humain ? Si on en doute, qu’on relise Racine ou Molière. Voudrait-on la cantonner dans le rôle de culture du patrimoine ?
La littérature est par nature vivante : pensons à Homère qui inspire Joyce ou les frères Coen. Il n’y a pas les œuvres qui seraient de patrimoine, et les autres. C’est l’exploration littéraire elle-même, et l’ouverture qu’elle permet sur un imaginaire riche d’enseignements et d’expériences inattendues, qui fait patrimoine.
Pour amener leurs élèves à cette richesse immense, les enseignants ont besoin que l’institution ait confiance dans leur expertise professionnelle, qui s’élabore au quotidien dans la classe. Ils ont besoin de temps pour familiariser leurs élèves avec une littérature qui les impressionne parfois, dont ils ont du mal à croire qu’elle est écrite aussi pour eux, et qu’elle a, même venue des profondeurs des siècles, beaucoup à leur offrir.