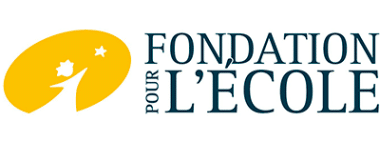On nous rebat les oreilles avec« l’école de la République ». Il est temps de passer au crible de la critique cette malheureuse expression. Eh quoi ! Les écoles publiques sont-elles les seules à appartenir à notre République française, les écoles privées en étant exclues ? Professeurs, élèves et parents de l’école libre ne seraient-ils pas des citoyens à part entière ? Serait-elle subitement abolie, la décision du Conseil constitutionnel de 1977 faisant de la liberté d’enseignement « l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946 et auxquels la Constitution de1958 aconféré valeur constitutionnelle » ?
On nous rebat les oreilles avec« l’école de la République ». Il est temps de passer au crible de la critique cette malheureuse expression. Eh quoi ! Les écoles publiques sont-elles les seules à appartenir à notre République française, les écoles privées en étant exclues ? Professeurs, élèves et parents de l’école libre ne seraient-ils pas des citoyens à part entière ? Serait-elle subitement abolie, la décision du Conseil constitutionnel de 1977 faisant de la liberté d’enseignement « l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946 et auxquels la Constitution de1958 aconféré valeur constitutionnelle » ?
Non, tout cela ne tient pas. Nous pouvons légitimement nous enorgueillir de ce que la République française offre à ses citoyens un libre choix (plus théorique que financier, hélas) entre des écoles publiques et des écoles réellement libres.
D’ailleurs, il est hasardeux de prétendre qualifier d’« école de la République » notre école publique actuelle. Croyons-nous vraiment que ses pères fondateurs s’y reconnaîtraient ? Déjà, un Condorcet se serait scandalisé de la transformation en 1932 de l’antique ministère de l’Instruction publique en ministère de l’Éducation nationale, lui qui affirmait avec force que « l’éducation publique doit se borner à l’instruction. » (Premier mémoire sur l’instruction publique, 1791, chapitre V). Et puis – et c’est un argument massif ! – Condorcet est hostile au monopole de l’école publique. Selon lui, si elle n’est pas concurrencée de l’extérieur, l’école publique ne peut que dégénérer ; la bonne qualité du service public d’instruction est garantie par l’existence distincte d’un réseau privé. L’existence d’un aiguillon extérieur est donc d’utilité publique. Dans son système, « tout citoyen pouvant former librement des établissements d’instruction, il en résulte pour les écoles nationales l’invincible nécessité de se tenir au moins au niveau de ces institutions privées » (discours devant la Convention nationale, 20 décembre 1792). L’école privée est donc nécessaire à la République. Rappelons que c’est justement la mission statutaire de notre Fondation que de jouer ce salutaire rôle d’aiguillon pour l’école publique ou liée par contrat à l’État.
Desserrer l’étau idéologique, juridique et financier qui étouffe l’école privée contribue, paradoxalement, à sauver notre école publique. Puisse l’État encourager davantage la société civile, par des mesures fiscales appropriées, à créer et financer des écoles libres.
Partager sur :
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp