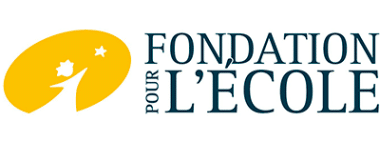Par Catherine Lucquiaud, docteur en informatique et chargée des questions numériques à la Fondation pour l’école
Il y a déjà vingt ans que nous avons quitté le XXe siècle des deux premières guerres mondiales pour entrer pleins d’espoir dans le XXIe et découvrir déconcertés que les guirlandes clignotantes ne font pas Noël. Le bruit déjà assourdissant de la diversion enfle sans cesse, les slogans imbéciles enivrent, la course à l’innovation devient frénésie. La liberté individuelle s’étiole, emprisonnée dans un carcan qui se resserre à présent de semaine en semaine. Son exercice devient difficile, l’apathie gagne, la sclérose menace…
Pourtant, il y a un peu plus d’un siècle, l’école républicaine était censée offrir à tous l’émancipation intégrale par l’accès à la connaissance : connaissance des savoirs humains accumulés par des siècles de civilisation, connaissance de soi et de l’autre par une vie sociale élargie et enrichie. L’une et l’autre devaient développer conjointement la capacité de chacun à prendre en main son destin, à faire des choix libres et éclairés, à tailler et polir sa pierre pour consolider l’édifice démocratique commun. L’idée était belle, source d’espoirs infinis : à travers l’institution scolaire, l’état promettait à chacun, quels que soient son milieu social et ses moyens financiers, de pouvoir bénéficier de l’éducation de qualité qui lui offrirait enfin la vraie liberté.
Certes, l’école gratuite, laïque et obligatoire de Jules Ferry n’a jamais été totalement désintéressée. Même sans l’avouer directement, elle visait avant tout à former de bons citoyens, dégagés de l’influence excessive de l’église et capables de participer activement à l’essor de la nation par l’industrialisation.
Il n’en reste pas moins que, pendant près d’un siècle, l’école publique a bon gré mal gré répondu aux attentes suscitées par les discours politiques. Se donnant les moyens de ses ambitions, trouvant finalement, fût-ce par hasard, un équilibre assez juste entre exigence pragmatique dans la formation des futurs enseignants et liberté pédagogique dans l’exercice de leurs fonctions, l’institution scolaire a globalement tenu ses promesses. Assez en tout cas pour générer des vocations sincères de professeurs et pour que de nombreux parents qui avaient les moyens d’assurer l’instruction de leurs enfants à domicile ou dans des établissements privés fassent librement pour eux le choix de l’école publique et s’en estiment satisfaits pendant toute leur scolarité.
Tous ceux qui souhaitaient néanmoins, quelle qu’en soit la raison, offrir à leurs enfants une éducation différente en conservaient cependant la possibilité, des garde-fous effectifs permettant de limiter les cas, rarissimes, de dérives de toute nature. Dans les faits, sans être proclamée comme telle, l’école a donc été a priori une « école de la confiance », de l’état envers ses concitoyens. Confiance accordée aux enseignants quant à leurs compétences et leur engagement au service des élèves, confiance accordée aux parents quant à leur volonté et leur capacité de faire des choix conformes aux intérêts de leurs enfants. Pour l’essentiel, en matière d’éducation comme de santé, l’état proposait, mais les familles et les individus pouvaient encore disposer, au moins dans une certaine mesure. Le principe de subsidiarité était beaucoup moins évoqué mais nettement plus respecté qu’il ne l’est aujourd’hui.
Quelques décennies auront sérieusement mis à mal un équilibre aussi fragile que précieux. Inlassablement dénoncé depuis les années 90, souvent de l’intérieur par les enseignants eux-mêmes, longtemps nié contre toute évidence, le douloureux naufrage organisé de l’éducation nationale aura finalement été rendu manifeste par les enquêtes internationales successives PISA et TIMSS.
En attendant qu’une institution à laquelle chacun était attaché retrouve ses esprits, parents, enfants et professeurs, parfois titulaires de l’éducation nationale, ont pu se tourner avec soulagement vers les écoles indépendantes ou l’instruction en famille. Le nombre de créations d’écoles alternatives a en effet connu une augmentation constante au cours des dix dernières années, accueillant des élèves aux profils variés, parfois issus de milieux sociaux défavorisés, grâce à la diversité des pédagogies et des conditions proposées aux familles. Des structures à taille humaine, très majoritairement initiées et portées par de petits groupes de parents et d’enseignants soucieux avant tout de l’intérêt des enfants et capables d’assumer des choix pédagogiques en conséquence. Des structures « agiles » et « en lien direct avec le terrain » suffisamment motivantes pour les équipes éducatives au point qu’elles acceptent souvent une charge de travail plus importante et des salaires inférieurs à ceux pratiqués au sein de l’éducation nationale, pourtant déjà considérés comme peu attractifs. Des structures dont, pour toutes ces raisons, les ministres de tous bords qui se sont succédé rue de Grenelle auraient pu s’inspirer avec profit, pour refonder l’éducation nationale sur des bases locales, en s’appuyant sur les principaux intéressés que sont les parents d’élèves et les enseignants.
Une autre voie a cependant été imposée. Malheureusement, si la confiance s’accorde et se mérite, elle ne se décrète pas. Bafouée, elle peut même générer une défiance légitime.
Alors qu’ont été largement avancés les arguments de la continuité pédagogique « en distanciel » et de la souveraineté éducative du pays face aux GAFAM/BATX (Google-Amazon-Facebook-Apple-Microsoft/Baidu-Alibaba-Tencent-Xiaomi) pour justifier la disparition des manuels scolaires et le recours massif aux EdTech françaises de la maternelle à l’université, il est déplaisant de constater, pour quiconque creuse un peu le sujet, d’une part que la crise de la Covid-19 n’a fait qu’accélérer des transformations déjà décidées en amont, d’autre part que les orientations en principe choisies par la République française en matière d’éducation respectent en tous points non seulement les préconisations détaillées de l’Union européenne, mais également celles de l’UNESCO.
Ainsi les propositions issues du Conseil scientifique de l’Éducation nationale (mis en place début 2018 par Monsieur Blanquer), des états généraux du numérique ou du Grenelle de l’éducation (organisés entre juin et décembre 2020 par le ministère de l’éducation nationale), loin d’avoir fait l’objet de débats réellement ouverts, n’ont-elles fait qu’enregistrer les objectifs préalablement fixés par l’Europe (via la Stratégie de Lisbonne en mars 2000 puis la Stratégie Europe 2020 en juin 2010) et par l’UNESCO.
Souveraineté éducative, certes, mais à l’échelle internationale : la France ne décide plus, elle s’aligne ; elle n’invente plus, elle copie sur ses voisins.
Sous le titre « Planifier l’éducation à l’ère de l’IA : un bond en avant », une conférence s’est tenue du 16 au 18 mai 2019 à Beijing, organisée par l’UNESCO et le ministère de l’éducation de la République populaire de Chine. Accueillant « plus de 500 participants de plus de 120 états membres, dont 70 ministres », elle a consisté en un véritable plaidoyer pour renforcer l’usage éducatif de l’IA et « développer les compétences destinées à permettre aux hommes de s’adapter à une société où l’IA a toute sa place ».
Faut-il encore s’interroger sur l’origine du soudain engouement de l’institution scolaire pour l’IA en dehors de tout débat véritablement contradictoire ? Et pour les parents qui souhaiteraient éviter ce monde de cauchemar à leurs enfants en les ouvrant à d’autres rêves, ne reste désormais plus que l’espoir de tomber sur un des derniers professeurs encore en mesure de résister au sein de l’institution, ou l’enseignement hors-contrat.
Pour combien de temps, maintenant qu’a été pratiquement supprimée la liberté d’instruction en famille dont chacun pouvait jusqu’ici bénéficier ? Comme l’a démontré Bernard Charbonneau avec une lucidité implacable dans son ouvrage central (L’état, écrit à la fin de la Seconde Guerre mondiale mais publié en 1980), la tendance irrépressible de l’état est de devenir totalitaire. L’état communiste, l’état national-socialiste ou l’état fasciste n’étaient peut-être que différents symptômes d’un même mal, qui constituent a posteriori autant de prétextes idéologiques confortables pour permettre à chacun de disqualifier hâtivement, selon ses goûts, l’idée même de communisme, de socialisme ou de libéralisme, avec autant de facilité que de bonne conscience.
Après les travaux de Léopold Kohr (L’effondrement des puissances) et d’Olivier Rey (Une question de taille), il n’est pas déraisonnable d’envisager que l’origine du problème puisse résider davantage dans la taille de l’organisation et sa volonté de puissance que dans la doctrine affichée. Sachant que les risques identifiés à l’échelle d’une nation prennent logiquement une ampleur d’autant plus grande à l’échelle d’un continent ou du monde, le temps semble venu de se poser quelques questions : en matière d’éducation, où s’exerce en France, en 2021, la souveraineté de l’individu, de la famille, du peuple ? Une gouvernance européenne ou mondiale de l’éducation est-elle réellement souhaitable ? Qui doit en décider et sur quelle base ? Qui doit s’y conformer et au nom de quoi ?
La normalisation des prises électriques ou des chargeurs de téléphones est sans doute une bonne chose. Celle des fruits, des légumes ou des fromages de terroirs est loin de faire l’unanimité tant elle a donné lieu à des dérives regrettables. Celle des dispositifs éducatifs serait dramatique, à plus forte raison à l’échelle planétaire. L’égalité des hommes ne passe pas par l’uniformisation. La vigilance indispensable doit parfois s’exercer ailleurs que là où on se complaît à l’assigner : une société digne, une démocratie véritable sont à ce prix.